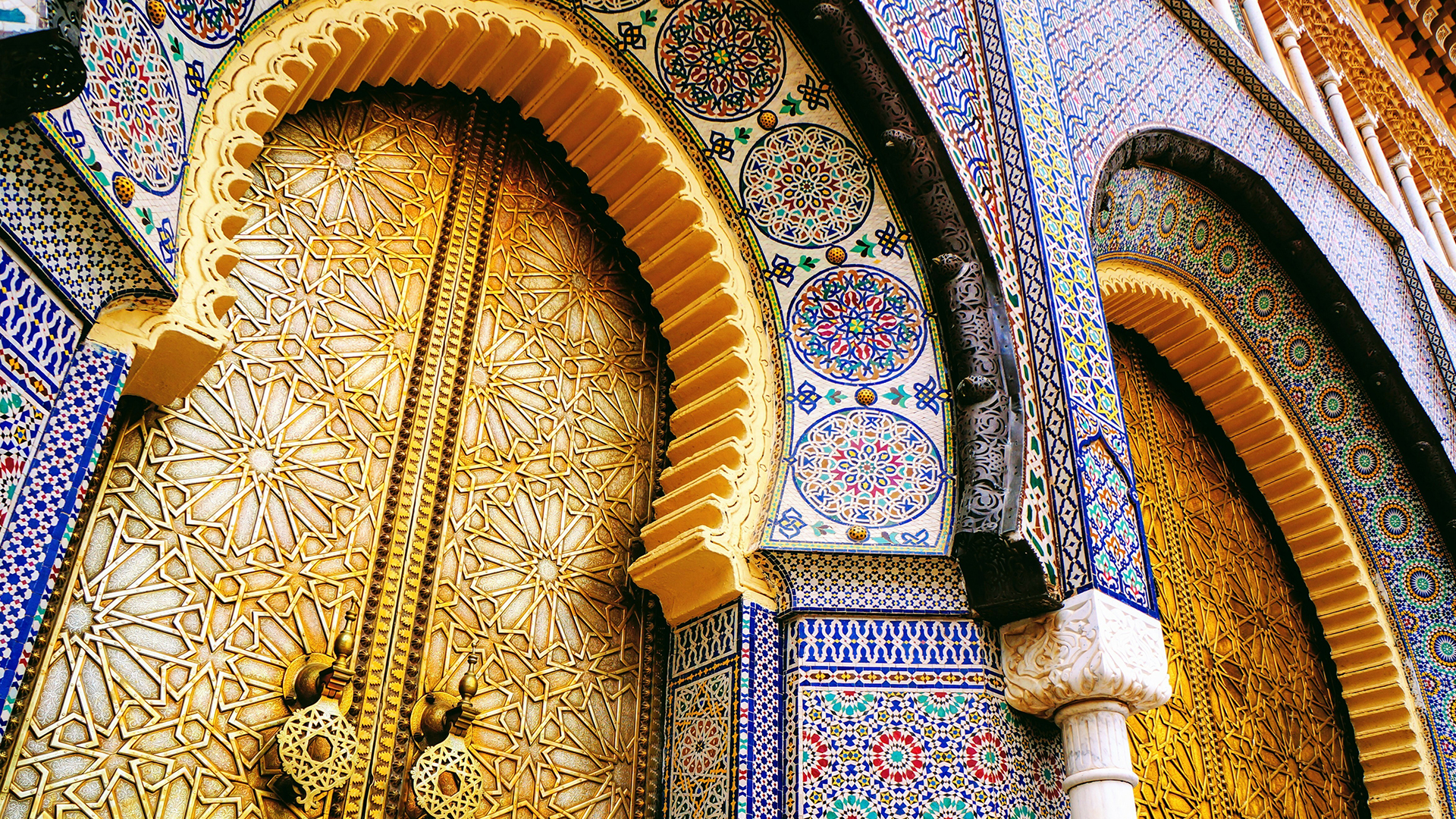1. Les principaux éléments constitutifs d’un programme de conformité
Le Guide manifeste la volonté du CC d’accompagner les entreprises et organisation professionnelles (OP) ayant des activités au Maroc dans la mise en œuvre d’une véritable culture de conformité. On peut regretter que le CC semble exclure que la mise en place de tels programmes puisse donner lieu à des réductions d’amende en cas de poursuites. Toutefois, ces programmes n’en revêtent pas moins un intérêt majeur, celui de minimiser le risque d’infractions, et ainsi de sanction, d’autant plus que les récentes affaires ont révélé l’intention du CC d’imposer des sanctions atteignant le plafond légal de 10% du chiffre d’affaires mondial consolidé...
Particulièrement pédagogique, le Guide explique en détail le contenu minimum que doit revêtir un programme de conformité pour être efficace, tout en soulignant qu’il doit être adapté en pratique à la situation de chaque entreprise ou OP afin de tenir compte de ses spécificités. Cinq piliers sont ainsi présentés comme nécessaires :
- l’engagement et le soutien des instances dirigeantes pour respecter les valeurs et règles de la concurrence ;
- la désignation de relais en interne responsables de la gestion du programme de conformité ;
- la mise en place d’un document cadre (code de conduite, manuel de conformité, etc.) et de procédures appropriées ;
- l’information, la communication, la formation et la sensibilisation ; et
- l’identification et la maîtrise des risques de non-conformité au moyen d’un processus de hiérarchisation.
Pour être pleinement efficace, le programme de conformité doit reposer sur une approche à la fois préventive et curative, afin de permettre l’identification et la gestion des risques concurrentiels. Il ne suffit donc pas de prescrire des règles, encore faut-il en contrôler le respect (soit en interne, soit en recourant à des conseils externes), prévoir le cas échéant un dispositif d’alerte, ainsi que des mesures disciplinaires (sanctions en cas de manquement, mais aussi incitations éventuellement par des primes ou promotions).
2. Panorama explicatif des règles de droit de la concurrence
Pour ceux qui en auraient douté, le CC confirme qu’il entend se placer dans la même lignée que ses homologues sur la scène internationale. De fait, le panorama (non exhaustif) qu’il dresse en annexe du Guide présente de nombreuses similitudes avec les lignes directrices d’autres autorités, telles que la Commission européenne.
Sans pouvoir entrer dans le détail de toutes les règles présentées par le CC, certains points d’attention peuvent néanmoins être relevés.
Notion d’entreprise
Pour les entreprises au Maroc peu familières avec le concept d’entreprise en droit de la concurrence, qui n’équivaut pas à celui de société, le CC apporte une clarification bienvenue en soulignant que cette notion « englobe toute entité, dotée ou non de la personnalité juridique, à condition que celle-ci exerce une activité économique. En effet, le statut juridique de l’entité importe peu. Elle peut être aussi bien une personne physique ou une personne morale qu’une entité dépourvue de la personnalité juridique, comme un groupe de sociétés ou une succursale. »
Rappelons que cette précision est lourde d’implications, notamment :
- en cas d’infraction au droit de la concurrence, les amendes sont calculées sur la base du chiffre d’affaires consolidé du groupe ;
- en cas d’opération de concentration, les seuils de notification sont calculés non pas sur la base du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés directement parties à l’opération, mais de l’ensemble du groupe auquel elles appartiennent.
Ententes horizontales
Le CC souligne que le risque d’entente ne se limite pas aux accords formels, exprès ou tacites, entre concurrents, mais vise aussi les échange d’informations sensibles, et peut couvrir de nombreux objets et/ou effets anticoncurrentiels (prix, limitation de la production, répartition de marchés ou de clientèle, manipulations d’appels d’offres, boycott, etc.).
Les échanges d’informations sensibles constituent en effet l’une des principales sources de risques pour les entreprises et les OP, quels qu’en soient le lieu et le contexte. Le CC rappelle notamment qu’il convient de faire preuve d’une vigilance particulière:
- dans le cadre des organisations professionnelles ; le CC fournit des recommandations pratiques pour gérer leur participation, éviter tout sujet à risque, et au besoin, se distancier en cas de dérive des discussions ;
- en cas de projet de coopération quel qu’il soit (offre conjointe en appel d’offres, joint-venture, projet d’opération de concentration, etc.) ; là aussi, le CC adopte une approche traditionnelle en recommandant de limiter les échanges au strict objet de la coopération et au strict nécessaire, et de mettre en place des garde-fous (Chinese walls) afin de restreindre l’accès aux informations les plus sensibles, si possible à des conseils externes.
Le CC relève cependant que « les accords entre des sociétés appartenant à un même groupe échappent en règle générale au droit de la concurrence, l’ensemble des sociétés d’un groupe étant en principe assimilées, en droit de la concurrence, à une seule et même entreprise », une exception dont il faudra néanmoins attendre la pratique décisionnelle pour connaître ses conditions d’application.
Ententes verticales
Le CC fournit par ailleurs de nombreuses précisions utiles sur les risques d’effets anticoncurrentiels de certaines clauses pouvant être incluses dans des accords verticaux (tels que les contrats de distribution ou de fourniture).
On peut toutefois s’interroger sur certaines de ces précisions qui paraissent aller au-delà des positions généralement retenues par les autorités de concurrence, et semblent présager d’une approche plus stricte du CC, en particulier :
- s’agissant des prix de revente recommandés, le CC impose une obligation de vérifier que les prix ne sont pas largement suivis, et si c’est le cas, de cesser de recommander les prix ;
- les clauses de non-concurrence, de distribution exclusive, ou encore d’approvisionnement exclusif, semblent présentées comme ayant nécessairement des effets anticoncurrentiels ;
- la vente liée semble présentée comme une infraction potentielle, indépendamment de l’existence ou non d’une position dominante.
On peut espérer que le CC affinera son approche au fil de sa pratique décisionnelle, une analyse aussi stricte pouvant être difficile à appliquer en pratique. En effet, selon les circonstances, de telles clauses peuvent être objectivement justifiées, voire indispensables au fonctionnement de réseaux de distribution.
Abus de domination
En matière d’abus de position dominante, le CC semble également s’inspirer de la pratique internationale pour enrichir la liste des abus expressément visés à l’article 8 de la loi n°104-12 (refus de vente, discrimination, vente liée, etc.), y compris en y ajoutant des concepts particulièrement techniques tels que les prix excessifs et les rabais fidélisants, qui devront faire l’objet de précisions par la pratique décisionnelle quant à leurs conditions d’application.
On notera de même avec satisfaction que le CC précise, à l’instar de l’Autorité française, qu’un état de dépendance économique ne peut être caractérisé qu’à la condition de réunir cinq critères cumulatifs, ce qui devrait limiter les contentieux sur ce fondement : (i) part (importante) de l’entreprise dans le chiffre d’affaires du partenaire, (ii) notoriété de la marque/enseigne, (iii) importance de la part de marché du partenaire, (iv) inexistence de solutions alternatives, et (v) quasi-contrainte conduisant à la situation de dépendance (et non choix délibéré).
Concentrations
Enfin, le CC n’oublie pas de rappeler les règles applicables en matière de contrôle des concentrations, et apporte des clarifications utiles sur de nombreux points, en particulier sur les différents types d’opérations susceptibles de constituer une concentration. Notamment, le CC précise :
- l’ensemble des facteurs pouvant caractériser un changement de contrôle, et
- les critères selon lesquels une entreprise commune peut être qualifiée de « plein exercice », à savoir : (i) des ressources suffisantes pour opérer de façon indépendante sur le marché, et (ii) une activité allant au-delà d’une fonction spécifique pour les sociétés mères, ce qui implique de ne pas être tributaire de ses ventes ou ses achats aux société mères.